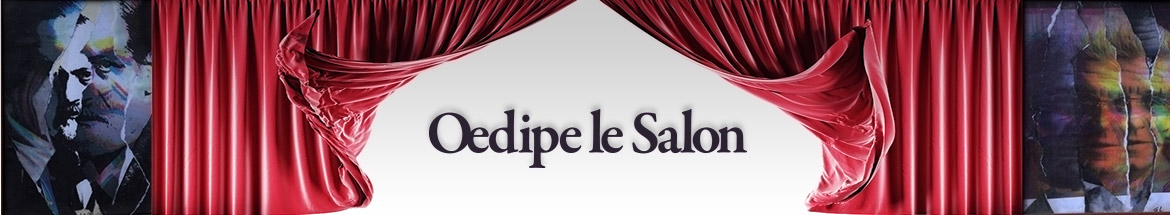Le livre de Caroline Eliacheff et Céline Masson : le sermon d’Hippocrate nous révèle qu’une véritable militance s’est institutionnalisée pour imposer une transidentité à la seule condition qu’il y ait une demande, quel que soit l’âge du demandeur et quoiqu’en pensent les parents. Ce sont souvent les jeunes de 15 à 18 ans qui se présentent à la consultation, candidats pour une transition de genre.
Avant d’entrer dans l’analyse de ces institutions, les auteurs nous présentent le journal d’une toute jeune fille et celui de son père.
Celui du Père retrace une prise de conscience progressive qui le conduira à un véritable combat contre l’institution prenant en charge sa fille. Tout d’abord inquiète par sa potentielle et possible homosexualité, elle est rassurée par son Père qu’elle ne sera pas rejetée par sa famille. Son malaise persiste et s’amplifie néanmoins. Elle regarde de plus en plus de contenus trans sur Instagram et sur youtube et elle a l’impression « qu’au fur et à mesure que je lis toutes ces choses, je fais de plus en plus de dysphorie ». Elle écrit une lettre à son Père « Pendant 15 ans, tu as eu une fille. Maintenant tu as un fils, signé : Élio ». Lou/Élio fait connaissance avec l’Abri: une association LGBT qui se propose de l’aider dans ses démarches. Son Père et sa mère prennent contact avec l’Abri. L’Abri se présente comme une protection pour les transgenres. Ils sont voués aux risques de harcèlement physique et psychique et à des taux de suicides extrêmement élevés.
« Mieux vaut un garçon vivant qu’une fille morte ». Puis deux médecins confirment son ressenti et enjoignent à ses parents d’engager sa transition sans discussion. «Le choc est rude” Malgré cette intervention médicale, tout en lui résiste. Ni l’Abri, ni la Directrice de l’école, ni l’assistante sociale n’ont jugé nécessaire d’informer les parents. David le référent de Lou/Élio indique par courrier qu’il n’y a aucune obligation légale d’avoir l’autorisation parentale.
Lou/Élio voit un psychiatre en consultation privée mais cette consultation a lieu dans les locaux de l’association militante dont dépend l’Abri. Même verdict. Agir sans tarder, risque de suicide très fréquent. On n’interroge pas un ressenti, percipio ergo Sum. C’est l’approche de la WPATH, association mondiale des professionnels de la Santé trans genre. Le Père n’accepte pas cette approche qui n’interroge pas la cause du problème. Le Père sans la mère revoit le psychiatre Il est celui qui sait ce qui est bon pour Lou. Ilne pose pas de questions ni ne s’en pose. « Questionner c’est faire souffrir ». À l’âge de 16 ans, en trois mois et après quatre séances individuelles, Lou/Élio reçoit un passeport pour se faire enlever les seins et démarrer sa prise d’hormones. Le Père, dorénavant, prend la décision d’aider sa fille à faire son propre chemin. Il tient son ex-femme au courant de son évolution. Ils tiennent Lou au courant de leur décision. Lou est KO, elle vient de recevoir un uppercut en pleine face. La mère rentre chez elle. Le père emmène Lou marcher.Le silence est la seule chose qui les lie puis Lou se laisse prendre sous le bras de son Père. Leurs pas s’enchaînent sans direction. Lou ne peut répondre à la question de savoir ce que signifie pour elle « être un garçon».Son Père se propose de l’aider à retrouver le pouvoir sur elle-même:varappe, écriture, théâtre, et psychothérapie pour analyser son malaise. Lou /Élio écrit à son psychiatre qu’elle suspend ses séances.
Lors d’un coup de fil à l’Abri, le Père constate que le supérieur de David arguant que l’approche affirmative est fondée sur le protocole de la WPATH et qu’à ce titre elle n’est pas discutable, considère que “je suis dans le déni des besoins de Lou/Élio” et il menace: on fera sans vous et nous signalerons le cas d’« Élio aux autorités compétentes”. Le père se rend compte qu’il est rentré avec l’Abri dans un rapport de forces. Il écrit à sa fille et lui exprime son envie qu’elle trouve son propre chemin.
Nous nous levons plus tôt pour faire de la gym. La tentative du père est « de constituer une présence, dans ses tâtonnements, voire dans ses errances….. ».
Lou a signifié à l’Abri qu’elle n’avait plus besoin de nouveaux entretiens et ils font une dénonciation infondée sans la prévenir. Elle est dévastée et se sent trahie. Elle ira témoigner auprès de l’Avocat qui lui a été nommé comme curateur. Le dossier est “classé sans suite. »
De façon franche et directe, Lou explique « qu’au cours de la vie, on découvre, on explore, on se questionne, on change ». Puis elle demande de l’appeler Lou et de la prénommer « elle » et conclut « Merci de votre compréhension et de votre bienveillance ». Le Père reprend la parole « Les errances sont parfois nécessaires”. « Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou » disait Nietzsche. Puisse ce témoignage, « donner à d’autres un peu de confiance dans leurs doutes et leur suggérer l’envie d’interroger »
C’est la fin de la première partie qui nous met au cœur des problèmes, c’est-à-dire le malaise que le corps à la puberté suscite.
Le second chapitre du livre : Anatomie d’une controverse rappelle l’état des controverses entre 2020 et 2024, très détaillé, il demande à être lu en entier. L’être humain étant un être parlant, il peut contredire en paroles sa réalité biologique. « L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est », dit Albert Camus.
Il est utile de lire ce deuxième chapitre dans tous ses détails pour prendre la mesure du combat nécessaire contre l’idéologie prévalante dans les décisions médicales.Cette militance allant jusqu’à ce qu’un groupe de jeunes vienne jeter des seaux d’excréments de chat dans le local où se tenait une conférence prônant le dégagement de l’idéologie trans affirmative.
Pratiquer une médecine au service d´une idéologie, retrace l’aventure de Lissenko sous Staline, d’Egas Moniz pour la lobotomie, la médicalisation des homosexuels, la castration de femmes et d’enfants au 19ème siècle.
Je ne m’attarde pas sur les détails, de même que je n’ai résumé le journal que côté Père, vous laissant le découvrir côté fille ou vous le donnant tel qu’il apparaît dans la parole du père, celui-ci s’adonnant à un combat qui est en résonance avec les auteurs de ce livre.
Ce combat, on le retrouve dans le chapitre 4, l’art de changer de sexe. D’où viennent les théories du genre. Les auteurs en font le recensement détaillé et je n’en garderai que les principaux points.
Dans ce chapitre, pour renoncer à des croyances, il faut prendre conscience que les représentations qui les soutiennent ne correspondent pas à la réalité. Les mineurs doivent presque tout à la personne controversée aujourd’hui de John Money. La promotion de l’identité de genre s’est réalisée par la publication à Amsterdam des premières préconisations pour les mineurs trans appelées « Dutch Protocole ». Aux États Unis, l’essor de ces préconisations est lié à la puissance de laWPATH.
Ses soutiens politiques, ses dérives sont semblables aux pratiques des croyants devenus fanatiques.
Pour ce qui est de la haine vertueuse de l’enfant, à l’instar des auteurs, je citerai Jacques Laçan : « l’objectivation de l’être humain dans notre civilisation correspond exactement à ce qui, dans la structure de l’ego, est le pôle de la haine.
La haine dans notre discours commun s’habille de bien des prétextes, elle rencontre des rationalisations extrêmement faciles ». La techno-médecine devient idéologie, lorsqu’elle tient l’homme pour toujours déjà à réparer, qu’elle rompt avec l’éthique et s’apparente à ce qu’il faut bien appeler une croyance, voire une religion » comme le dit Bruno Chaouat.
Enfin, le rapport Cass(2024), qui préconisequ’« une prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre doit privilégier une approche psychologique et psychothérapeutique classique ». Il est le fruit des voix convergentes pour prôner la fin de l’idéologie dans l’approche des « dysphories de genre ».
Le philosophe C. Godin a démontré que le post-humanisme traduit une haine de la condition humaine. Celle-ci risque de représenter l’un des plus grands défis pour les décennies à venir. Pour l’Angleterre, le rapport Cass marque la fin de la médicalisation abusive des jeunes souffrant de troubles liés au genre, Quant au journal Le Monde, la ligne éditoriale est restée inchangée : « favorable au modèle des soins ‘affirmatifs’ » pour les enfants”.
Aujourd’hui, le désir de changer de sexe cache parfois un véritable malaise, une envie de modifier leur corps, chez les filles, le rejet des formes qu’elles aimeraient effacer. Ces phénomènes sont, en citant Michel de Certeau, « à la fois des symptômes et des solutions transitoires à des ruptures et à des transformations civilisationnelles, moments aigus de ce «malaise dans la civilisation »
En conclusion, redonnons la parole à Lou. « J’envoie toute ma force et mon courage aux jeunes concernés, parce que je sais combien ils souffrent et combien cette souffrance est insupportable. J’espère sincèrement qu’ils et elles trouveront leur propre voie, hors des sentiers battus, pour apprendre à s’aimer.”

Edwige Encaoua, psychiatre et psychanalyste, a débuté à l’hôpital de Plaisir-Grignon, est intervenue pendant une vingtaine d’années au BAPU (Henri Barbusse), s’est installée comme psychanalyste à Paris puis à Bourg La Reine en 1988.