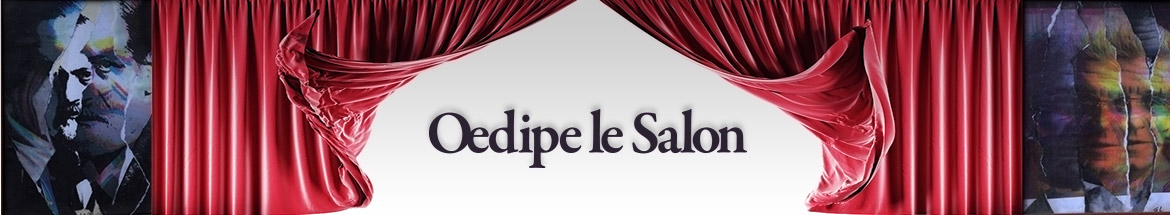Cet ouvrage rassemble un ensemble de textes issus de travaux réalisés au sein de l’École Freudienne autour de la question de la vérité, en tant qu’il n’y a de vérité pour l’analyste que celle, singulière, du sujet de l’inconscient. En prenant résolument appui sur des exemples cliniques, il s’attache à mettre en relief son statut particulier dans le discours et la pratique analytiques, à interroger les contours de son élaboration au fil de la théorisation de Freud et de Lacan, à cerner les positions du névrosé à son égard, ou encore à saisir la manière dont elle émerge au cœur de la cure… Loin de viser à l’exhaustion du thème, il propose plutôt différents angles d’approche et aussi différents point de vue qui témoignent de la façon dont chaque auteur s’est arrêté à ce qui pour lui définit une vérité du sujet en psychanalyse. Mais à travers eux, se fait fondamentalement entendre que si la vérité « qui parle je » constitue une dimension essentielle de l’expérience analytique, c’est dans la mesure même où on peut « juste la tutoyer sans jamais l’atteindre toute » (P. Herbert), et que c’est bien à partir d’un vide central, ici marqué de ce pas-tout de la vérité, que peut se soutenir une éthique du Réel.
Gérald Racadot part de la trace, à la racine de la symbolisation, pour y articuler le Réel du sujet, « c’est à dire sa jouissance à laquelle se rattachent des vérités intimes qui gisent dans la lettre et l’inconscient tant que la parole ne les a pas révélées ». Il aborde ainsi la question de la jouissance en tant qu’elle est engendrée chez l’être parlant par le signifiant qui l’écrit comme perdue, et rend compte du travail et de l’acte analytiques qui conduisent à l’émergence d’une vérité qui se noue au savoir sans s’y conjoindre.
Michèle Aquien clarifie ce qui différencie la justesse de la vérité. Elle reprend la question de la justesse des noms qui est au cœur du Cratyle, examine, à partir d’exemples pris dans des manuscrits, comment le poète travaille sur le signifiant, puis précise comment les deux notions s’articulent dans la cure, notamment comment la justesse, du coté de l’écoute analytique, entre en jeu dans le surgissement de la vérité, du côté du sujet de l’inconscient.
Patrick Herbert insiste sur le fait que la vérité ne peut être que mi-dite, mi-dire qui signe son échec. Il rappelle ainsi comment la question de la vérité s’est posée chez Freud au fil de sa théorisation jusqu’au repérage du trou du refoulement originaire, et discute de la construction de cette scène traumatique de coït a tergo dont l’Homme aux loups porterait l’empreinte. S’intéressant à cette Prägung, il éclaire le fonctionnement dans le psychisme de cet artifice qu’est l’écriture, et de l’entrée en jeu, dès l’origine, de la lettre qui n’est pas jouissance, mais signe de sa perte comme reste.
Catherine Mabit revient sur le Proton Pseudos de l’hystérique qui constitue un des apports cliniques et théoriques majeurs de l’Entwurf. Elle met patiemment en lumière les interrogations et les hypothèses de Freud sur la constitution, si problématique pour l’homme, de la réalité, puis elle déplie l’histoire d’Emma en attirant l’attention sur les faux nouages de la pensée qui aboutissent à ce « mensonge souverain » que se forge le sujet de la névrose confronté au sexuel traumatique.
Monique Bon illustre, à partir de trois exemples -celui de Christophe Colomb, de Champollion, de Léonard de Vinci-, la façon dont l’explorateur, le savant et l’artiste se confrontent, chacun à leur manière, à des vérités indomptables ; comment dans leur quête, ils flirtent avec un certain bord et sont conduits à dire sans savoir ou cacher ou falsifier des vérités. En creux, se pose la question de la mort et de la sexualité, avec ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire.
Patrice Poirier attire l’attention sur l’abord éthique de la clinique en soins palliatifs. À partir d’une situation, il montre comment la prévalence à l’hôpital de l’idéal d’un rapport pacifié et réaliste du patient à sa mort conduit à de fortes tensions dans le traitement de la vérité, marquées par l’embarras des soignants face à ce qui se présente de Réel pulsionnel. Rappelant alors la place de la mort dans le procès de la subjectivation ainsi que dans la vie psychique, il dénonce les forçages adaptatifs et plaide pour une écoute du sujet dégagée des attendus médicaux soignants.
Catherine Polsinelli conduit une réflexion sur la dialectique du savoir et de la vérité dans la tragédie d’Hamlet à partir de la lecture qu’en propose Lacan dans Le désir et son interprétation. Elle dégage quelques articulations de ce qui se joue pour le héros dont la singularité dramatique tient à ce qu’il est confronté, dès le départ de la pièce, à la levée du voile sur le savoir, et situe ce qui constitue le nœud conflictuel et tragique de son cheminement vers son destin.
Jean-Yves Méchinaud se penche sur le concept d’objet véritable en mettant en évidence les avancées essentielles qui ont mené à son élaboration. Il revient en particulier au cœur du fantasme fondamental où se révèle, comme nécessité structurale, la loi de la schlague qui vient rayer le sujet en le destituant en « un rien du tout » qui a pour équivalent a, l’objet qui choit. C’est ce a, unique à chacun, qui est l’objet véritable. Distinct des effaçons du sujet, il se définit comme ce reste de la découpe du Réel préalable tel que chacun l’appréhende au moment du refoulement originaire.
Annie Biton aborde la fonction logique et la dynamique interne du fantasme afin de définir son rôle de signification de vérité. Au fil d’une recherche assez foisonnante qui prend appui sur la distinction des registres du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire, elle présente l’ordre de vérité auquel est aliéné le sujet divisé, s’intéresse aux processus qui fondent la conscience de soi, et montre comment le fantasme soutient l’opération de subjectivation en donnant sa place au a, ce reste qui permet une opération de mesure par rapport aux champs de l’Un et de l’Autre.
Cheminant du Nom-du-Père au « Non dupe erre », Jean Triol démontre que la vérité du sujet se situe en ce point du refoulement originaire, point de castration ultime dont le « démenti » a causé sa division, si bien qu’en fin de cure, la position du sujet est de bien voisiner avec le Réel en se faisant sa dupe. Soulignant que le complexe d’Oedipe ne produit qu’une frustration, l’auteur insiste ainsi sur l’importance de la structure originaire qui lui est sous-jacente pour penser la castration, et interroge d’une façon neuve ce qu’il en est de la fonction du père dans l’évolution de la société.
Isabelle Garniron nous parle de la solitude et de la responsabilité dans l’expérience analytique où est en jeu l’énonciation par le sujet de sa vérité, une vérité d’abord en souffrance qui s’exprime par le mensonge du symptôme. L’acte analytique nécessite de la part de l’analyste une position éthique à l’égard de la vérité qui s’accompagne de solitude et de dépouillement, car il n’y a d’énonciation de la vérité que du fait de la castration, du lieu de « l’entre-deux-morts ». Le savoir inouï qui en émerge mène le sujet devant la responsabilité du choix de sa prise de position face à ce qui se révèle à lui.
Pierrick Brient déplie pas à pas le mathème S\/SA apporté par Lacan dans l’Acte psychanalytique, afin de rendre compte des deux positions du sujet de la névrose dans son rapport à la vérité : celle de l’hystérique, qui se présente au champ de l’Autre comme authentique dans son mensonge, au prix que le signifiant qui la détermine reste dans l’ignorance qu’il est oublié ; celle de obsessionnel, qui en faisant entendre le signifiant qui est sa vérité mais en le déniant, est sincère dans sa méconnaissance dénégative.
À partir du documentaire d’Andras Solymos, Un caillou sur la tombe, Robert Samacher interroge le destin du photo-journaliste Paul Almasy, né Pàl Gross, qui toute sa vie a dissimulé ses origines juives, et montre comment cette vérité cachée a émergé à la génération suivante. L’auteur s’attache notamment à cerner comment ce qu’on se cache à soi-même peut se manifester dans ce qui choit d’un regard et se fixer sur une photo, et se penche sur la nature de cet acte qui a consisté pour la fille de Paul Almasy à rajouter sur la tombe de son père son premier patronyme.
Dans la continuité des ouvrages collectifs déjà parus, Acte psychanalytique et transmission, Éthique du désir, La trace, Le temps dans l’inconscient et dans la psychanalyse, ce recueil témoigne du travail d’une école pour rendre compte le plus justement possible de ce que la clinique nous enseigne. D’une façon très vivante, il rend sensible la division du sujet entre savoir et vérité, ainsi que la dialectique vérité-mensonge inhérente l’existence de l’inconscient. Il montre comment la vérité se fait entendre dans la parole et est mise en jeu dans l’acte analytique. Enfin il donne la mesure de ce Réel du sujet à quoi elle touche dans sa structure de fiction, jusqu’au point de finitude de la cure. Loin de toute forme d’idéal, les textes ici présentés sont fondamentalement travaillés par ce rapport à la vérité incurable, marqué par le tranchant de la castration, de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, rapport à la vérité indomptable, impossible à dire toute, qu’il est nécessaire de garder pour maintenir, au travers de l’énonciation d’un savoir propre à chacun, le vif de la découverte freudienne.

Virginie Chardenet, psychanalyste, membre de l’École Freudienne.
A publié Destins de garçons en marge du symbolique, Paris, Corti, 2010 – « Sans fauteuil ni divan: le Club » en collaboration avec Monique Zerbib, Les Lettres de la SPF, n°24, Paris, 2010 – « Bêtises contées », Enfances&Psy, Paris, 2014.