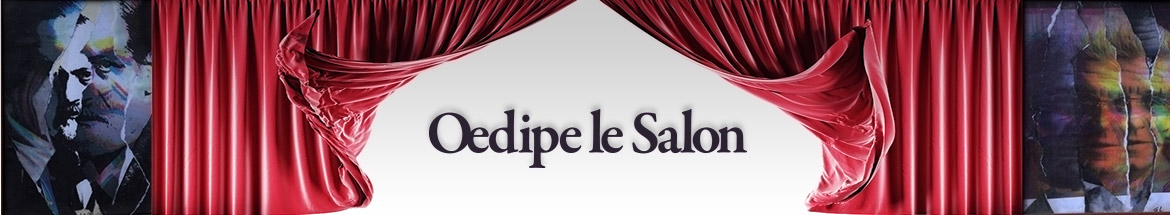Une fois de plus, un homme sain d’esprit devait rester à la Maison Jaune. István Holls
On est surpris par la quatrième de couverture que l’éditeur a écrite sur le livre de Gloria Leff. Comme si ce livre était un récit, avec une belle mise en scène historique et un solide scénario écrit pour des acteurs renommés, Sigmund Freud, Sandor Ferenczi et Ernst Federn pour ne citer qu’eux. Tout cela pour raconter l’histoire de l’un de ces précurseurs géniaux de la psychanalyse du vivant de Freud que fut Istvan Hollos en Hongrie.
Peut-être est-ce dû aux échanges que j’ai pu avoir Gloria Leff lors de la confection de son livre, mais ce livre porte avant toute chose sur la folie. Il contient une proposition d’importance qui porte sur la langue de la folie. De plus, elle prend appui sur les écrits d’Istvan Hollos qu’elle remet au goût du jour après une longue hibernation pour faire valoir les découvertes qu’il fit sur la folie. Est-ce dû au hasard, mais la découverte de travaux de Hollos s’avère être d’une étonnante modernité quand on lit par exemple les derniers travaux que Jean Allouch consacra à la folie.
Le livre est d’une telle richesse qu’il ne saurait être ici question d’en faire une recension. Aussi ai-je choisi de m’arrêter sur quatre points que j’ai trouvés d’importance sur la folie, surtout en raison du fait que, loin de clore les questions qu’ils traitaient, ils les ouvraient aux débats dont j’esquisserai ici certains.
Un exercice d’écoute du son particulier
Tout d’abord, on se demande quelle mouche a pu piquer ce psychiatre hongrois, en 1912, adepte de la psychanalyse, quand il osa écouter ceux que l’on appelait alors les fous. Ils parlaient, écrit-il, une langue marquée par l’étrangeté. Au lieu de se résoudre à attribuer ce caractère à la maladie de ses patients, il se décida à pratiquer un exercice qui visait à accorder toute son attention à leurs paroles. Cet exercice lui demanda de se familiariser avec l’étrangeté de leur langue jusqu’à ce qu’elle lui devienne familière, ce qui ne veut pas dire compréhensible ou déchiffrable. Gloria Leff va suivre de très près le propos de Hollos, ce qui va lui faire mettre l’accent sur l’atmosphère (Stimmung) dans laquelle son propos se tenait. Cette attention va l’amener à découvrir la spécificité d’une expérience poétique de l’un des patients. Elle cite le musicien Karlheinz Stockhausen :
On écoute. Il y a littéralement des vibrations, des ondes, des rythmes qui envahissent celui qui parle, l’imprègnent, puis se revêtent de mots, d’idées ou de musique de couleurs tout en s’affaiblissant (p. 100).
Le surgissement de mots inconnus qui venaient dans la bouche du patient suscitaient plus d’associations que leur signification et il en allait de même avec les sons produits par ces mots.
Gloria Leff produit à partir de sa lecture des travaux d’Hollos son approche de la folie. Elle va mettre l’accent sur la question du son et du rythme. Si Hollos prend ses distances vis-à-vis du signe et de son sens imposé par la langue, il accorde plus d’importance au sonore et à la musique. Il invite son patient à dire ses poèmes à haute voix. Quand il écoute son patient, il ne manque pas de dire que « ses phrases merveilleuses et colorées » provenaient d’une manifestation plus libre de l’inconscient (p. 105). Il note surtout que ce patient les dit dans une langue qui lui est propre et qui est associée à une logique particulière. Devant ce phrasé étrange, Hollos ne cherche pas à utiliser l’interprétation des rêves pour tenter de découvrir le sens caché de ces phrases.Il ne cherche pas à les comprendre. Il fait un geste différent : il renonce à modifier le texte du poème qui aurait visé à lui donner sens et cohérence. Il n’ajoute rien à ce qui se présente comme maillon manquant du poème. Gloria Leff écrit :
[Hollos] signale avec raison que lorsqu’il improvisait lentement ses poèmes, le patient les disait comme « s’ls avaient été créés en union avec son “moi”. Il n’y avait aucune « erreur » à corriger, aucun sens à ajouter, parce que « le rythme et la danse se trouvaient [en lui] comme une loi extatique biologique dans l’arbre vivant, qui créait un feuillage rythmique uniforme, harmonieux, même entre les branches irrégulières » (p. 106).
Écouter la poésie de son patient réclamait de la part de Hollos un exercice particulier qui supposait une importante remise en cause de son rapport au savoir. Il lui a fallu oublier la « Science » pour entendre la langue « distordue » de ce patient. Ainsi l’analyste doit-il renoncer à ce qu’il veut savoir sur son analysant et surtout pour parfaire son exercice d’écoute, il est invité à se déprendre de la quête du sens. Dans cet exercice, l’analyste s’apparente au poète et au fou.
Une discussion de Hollos avec Artaud sur les unités élémentaires est-elle possible ?
Dans son dernier ouvrage, Le cocher inconnu, Hollos parle de Phatra, cet ancêtre qu’il invente. C’est un poète/fou, ou un fou/poète. L’analyste va s’apparenter à ce poète/fou. Cela lui permet de se laisser inspirer par la musique du son. Privilégier le son des paroles entendues aux dépens du sens, voilà l’affaire !
La force des mots ne reposait pas sur leur sens profond, mais sur leur son et le rythme des deux mots prononcés ensemble dans lesquels résonnaient « toutes les aspirations et les promesses de grandeur future du noble peuple » (p. 120).
Gloria Leff poursuit :
Avec humour et curiosité,[Hollos] se laisse guider seulement par le son et permet ainsi au murmure des mots incompréhensibles de résonner en lui. Il ne sait pas ce qu’il dit : les mots, les sons et les morceaux effilochés de paroles rebondissent, se réverbèrent et s’articulent les unes sur les autres.(p. 121)
Ces paroles qui ne font pas sens sont bien dictées par le son et le rythme, prises qu’elles sont dans la musicalité qui ici prévaut. Dans le passage du livre intitulé Phatra, un des ancêtres qu’il invente, Hollos se laisse inonder de bruits, de bourdonnements qui constituent une masse de sons hétéroclites en mouvement. Ils se déversent dans son oreille en « cascades ». Le langage qui apparaît alors n’est fait ni de phrases, ni de propositions mais « d’une multiplicité inconsistante d’éléments de son sans sens ». Tout tient ainsi dans la formule : des sons et des morceaux effilochés de paroles tissant une composition qui ne vaut que pour qui la produit (p.122).
En mettant l’accent sur le son et le rythme d’une parole effilochée, on se demande si, avec cette approche, Gloria Leff ne néglige pas la littéralité qui est à l’œuvre dans ces étranges productions. Elle donne cependant un exemple qui démonte cet argument.Dans Phatra, on découvre un agglomérat de lettres que j’appellerai « unité élémentaire de langage ». La voici (p. 120) :
Griffandzitar Glutando.
Les érudits vont se précipiter sur cette formation que l’on peut difficilement dire être faite de « mots ». Ils la décortiqueront et trouveront diverses explications qui porteront tant sur sa formation que sur sa signification.
Cette unité composée par deux éléments littéraux me paraît entrer en résonnance avec les glossolalies d’Antonin Artaud. Elles aussi étaient des morceaux effilochés de paroles, faits de syllabes inventées qu’il introduisit dans ses textes à partir de 1943. Pour prendre un exemple, dans une lettre au docteur Ferdière qui date du 29 mars 1943, il écrit sur un poème de Ronsard[1] :
Ronsard a fait de la Magie et il était initié et chaque vers de son poème est un reflet de cette initiation transcendantale. Cette initiation est mystérieuse.
Rat Vahl Vahenechti Kabhan
[…]Un peu plus tard, dans le même texte apparaît une autre écriture énigmatique :
Taentur Anta Kamarida
Amarida Anta Kamentür
Il est remarquable qu’Artaud fasse intervenir dans cette lettre des morceaux syllabiques sans en donner d’explication nien fournir un commentaire. Ils paraissent surgir sans raison et faire rupture avec le reste de l’écriture qui se poursuit dans une langue compréhensible.
Ne sommes-nous pas avec Rat Vahl Vahenechti Kabhan devant des paquets de lettres du même acabit que celui que Gloria Leff a trouvé chez Hollos avec le Griffandzitar Glutando? Ne peut-on pas tenter une lecture de ces unités élémentaires du langage chez Hollos comme chez Artaud à la lumière du surgissement du code propre dans le code commun de la langue ? Il ferait alors irruption et rupture dans l’énoncé quand ce dernier a une visée de communication. Cette irruption des paquets de lettres n’appelle dans les deux cas aucune interprétation. Car, en tant que telle, elle est et reste résolument énigmatique. Elle ne vise d’aucune manière la communication d’un sens.
L’irruption de ces syllabes inventées semble bien témoigner de l’émergence des interdits de la langue dans la langue commune, celle dont parle Foucault[2]. Ici ils font effraction en provoquant une rupture du sens dans le texte.
Vouloir lui donner une interprétation reviendrait à oblitérer ce qu’il y a d’écriture véritable dans ce passage. Cette irruption de toute façon est une menace d’effondrement de la langue commune sous les coups du caractère non-sens des unités élémentaires du code propre. Le gras des lettres souligne le caractère violent et disruptif de l’effraction de ces unités élémentaires dans la langue commune.
On rappellera ici parmi d’autres textes d’Artaud ce passage de Et ils, ont tous foutu le camp :
dakantala
dakis tekel
ta redaba
ta redabel de la douleur suée dans l’os
Tout vrai langage
est incompréhensible,
comme la claque
du claque-dents ;
ou le claque (bordel)
du fémur à dents (en sang)
Pour Artaud, tout vrai langage est incompréhensible comme si les unités élémentaires qui le constituent étaient premières.Cette affirmation est suivie d’une série de jeux de mots quasi homophoniques. N’est-ce pas ce que nous montre le travail de Gloria Leff dans son analyse du texte de Hollos ? Oui, chez Hollos, on trouve aussi du vrai langage. Aussi peut-on proposer que le rapprochement ici effectué entre Hollos et Artaud est fondé.
Sur le transfert de pensée
Il y a le cas où l’intervention de l’analyste prend une tournure particulière :
Parfois, nous faisons l’expérience de ce que, après un long travail analytique et malgré des interprétations pertinentes, malgré la compréhension du patient, le symptôme ne cède pas, jusqu’à ce qu’une parole soudaine qui s’impose, joue comme une illumination (Erleuchtung). Le vieux problème se trouve résolu, la situation qui avant n’était que comprise, est intégrée de façon convaincante, sans que l’on puisse trouver une explication à ce miracle de la parole même qui a donné lieu à cette évolution. (p. 139)
La liberté de l’analyste dans son exercice joue un rôle déterminant dès lors qu’il insère dans son exercice l’usage de l’illumination. Non pas qu’il en use comme on le fait d’un instrument ou d’un outil, mais parce qu’il accepte de donner à cette dernière toute sa portée. Gloria Leff relie illumination et liberté:
La séquence liberté/illumination — avec laquelle Hollos définit le transfert de pensée qui se serait effectué entre patient et analyste — rend évident que la liberté de l’analyste aura été la condition de l’illumination et que l’interprétation dans laquelle l’éclair était intervenu, était aussi fragile que délicate. (p. 140)
Le transfert de pensée pose en effet un problème d’importance. Très souvent il a été conçu comme un transfert qui partait d’un émetteur et qui arrivait à un récepteur. Soit la mise en rapport de deux personnes dont chacune avait son lieu. Or Hollos s’écarte de cette conception. Non seulement il articule de façon explicite l’illumination et la liberté de l’analyste, mais il constate ce que lui apprend son exercice de l’analyse dans ce cas de figure : il n’est pas possible de déterminer précisément qui est l’émetteur et qui est le récepteur d’un message télépathique. Ceci l’amène à une remise en question de la distinction entre émetteur et récepteur[3]. Gloria Leff écrit que ceci pouvait mener à « un rapport marqué par une réciprocité qui donnait l’illusion du “Un” : avoir la même pensée, partager les mêmes signifiants […][4] ».
L’analyse s’exerce au neutre
Hollos est donc celui qui s’est laissé enseigner par ses patients. Plus exactement par l’un de ses patients qui lui disait ses poèmes.Or écouter un tel patient suppose que l’analyste témoigne de sa fragilité. Il s’expose à l’effondrement de ses repères, de « tous les repères » (p. 130). C’est sur ce point que Gloria Leff fait entrer le neutre. Ce n’est pas la position du déchiffrement ou de l’interprétation qui caractérise l’analyste. Un tel positionnement nécessite de sa part « un travail » sur lui-même. Elle ajoute : « Ce n’est pas pour rien que, pour Barthes, le neutre peut se manifester comme “la suspension de l’interprétation, du sens” ».
Ainsi,
En lui permettant de s’exprimer à travers sa propre grammaire et ses propres images, Hollos s’est rendu compte qu’il ne comprenait pas : il n’y avait pas moyen de comprendre, le code de son patient n’était pas le sien, il ne pouvait enfermer les paroles de son patient dans des notions nosographiques, mais pas non plus dans sa propre langue, sa propre syntaxe, ses propres métaphores ; il ne pouvait pas introduire le sens de son code là où il s’agissait probablement d’un autre sens qui lui restait inaccessible ; il n’y avait ni réponse, ni explication, ni déchiffrement, ni interprétation possible. Il n’y avait plus là qu’un trou dans le savoir ; Hollos en prend acte et fait face àsa propre fragilité. (p. 131)
Après avoir démontré que la position de Hollos devant ses œuvres écrites revenait à disparaître en tant qu’auteur, Gloria Leff indique que ce geste lui a permis de mettre en place son accès au neutre. Elle souligne combien cet accès s’est ouvert au moment même où il s’est trouvé « en position de reconnaître l’altérité radicale des paroles confuses et incompréhensibles de son patient poète ». Cette altérité, rappelle-t-elle, en citant Blanchot dans l’Entretien infini, « se tient sous la nomination du neutre » (p. 166). Ces paroles, écrit-elle, ne sont pas faites pour reconquérir ni un objet, ni un sujet ni le temps. Elles dévoilent « la possibilité vide et neutralisée du sens ». Elle donne une citation de Barthes qui propose une approche inhabituelle du neutre :
Je veux dire par là que, pour moi, le Neutre ne renvoie pas à des « impressions » de grisaille, de « neutralité », d’indifférence. Le Neutre — mon Neutre — peut renvoyer à des états intenses, à des états forts, à des états inouïs. « Déjouer le paradigme », puisque tel est ce qu’est le Neutre, peut être une activité ardente et brûlante[5] .
Que de fois n’entend pas, quand on parle du neutre, le souci de ne rien affirmer, de tout mettre au conditionnel, d’amortir à tout prix le moindre propos, que l’on se surprend à lire ce propos de Barthes. On oublie trop souvent que le neutre suppose une activité ardente, brûlante et désespérée, ce que Jean Allouch n’a pas manqué de mettre sur le titre de son ouvrage posthume quand il souligne la vitalité du neutre ! Bref, le neutre n’est pas trempé dans la fadeur. Bien plutôt ses états sont-ils intenses, forts, inouïs. Tel est le cas de l’exercice de l’analyse de Hollos qui ne s’arrête jamais devant les défis qu’il l’oblige à relever. Oui, si l’analyse s’exerce au neutre, comme le dit Gloria Leff, c’est que la position qu’a adoptée Hollos en acceptant de n’avoir aucune réponse, interprétation, explication, aucun déchiffrement possible suppose une conquête brûlante et une position active de l’analyste, celle qui revient à écouter ce qu’il ne comprend pas.
Stimmung
On comprend maintenant en quoi l’ouvrage de Gloria Leff a pu prêter à équivoque. En effet, dans son souci d’immerger Hollos dans son temps, dans ses relations, on peut penser qu’elle se livre à une analyse du contexte où Hollos a évolué. Ce n’est pas faux.
Mais ce milieu, cette époque, la vie quotidienne à Budapest avec ses cafés, ses lieux de rencontre dans un atmosphère bouillonnante, lui ont parlé, à elle, comme ils ont parlé à Hollos. Tout comme Artaud chez les Tarahumaras a découvert que là-bas, la Nature parlait, à Budapest, régnait une atmosphère, une Stimmung qui a parlé à Hollos. Ce sera peut-être là la proposition la plus provocante de son livre sur la folie : c’est que tous, aussi divers que nous soyons, nous participons à la folie.
George-Henri Melenotte
[1]Antonin Artaud, « lettre du 29 mars 1943 au docteur Ferdière », Œuvres complètes, Lettres écrites de Rodez 1943-1944, t. X, Paris, Gallimard, 1974, p. 24.
[2]M. Foucault, « La littérature et la folie », Folie, langage, littérature, Paris, Vrin, 2019, p. 89 ; également : Michel Foucault, Conférence inédite « La littérature et la folie », Critique, no835, 2016, p. 965-981.
[3] Gloria Leff me précise que cette conception, que l’on peut lire dans l’article de Hollós sur les «phénomènes télépathiques », ne peut provenir que de l’expérience qu’il a eue avec son patient poète. C’est son expérience de la folie qui lui permet de donner cette réception à ce type de phénomènes.
[4] Ce point nécessite une analyse détaillée de ce que Lacan a apporté avec son recours à la lalangue et les précisions qu’il a données sur l’autisme à deux, qui, l’une comme l’autre, sollicitent le commun.
[5] Roland Barthes, Le Neutre : Cours au Collège de France, Paris, [1978] 2002, format kindle, p. 50.