Cabinet de lecture : Annik Bianchini nous donne son avis |
 |
|
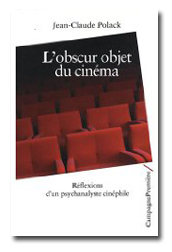 |
“Le cinéma, en démultipliant ses techniques et ses dispositifs, me semble l’art le plus apte à chercher, du côté de l’insu, de l’innommable et de l’obscur, la matière sensible et chaotique du désir… A la sortie d’une séance, l’envie me prend parfois, de prolonger un effet, un affect, une émotion, une surprise, de leur donner une forme, de les traduire en mots.” C’est de cette compulsion immédiate que Jean-Claude Polack, psychanalyste et cinéphile, cherche ici à rendre compte, sur des films qui l’ont touché et qui, par ce qu’ils ont suscité chez lui, nourrissent sa réflexion sur les affinités entre le cinéma et les productions de l’inconscient, sur la place du désir dans le langage cinématographique. Psychiatre, psychanalyste, Jean-Claude Polack a travaillé pendant une douzaine d’années à la clinique de La Borde (fondée par Jean Oury), creuset de la psychothérapie institutionnelle. Il est directeur de la revue Chimères, fondée en 1987 par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Il a publié La Médecine du Capital (Maspero, 1971), La Borde ou le droit à la folie (Calmann-Lévy, 1976), L’Intime Utopie (PUF, 1991), Epreuves de la Folie (Ères, 2006). |
|
Ses réflexions sur le cinéma vont au-delà des cadres usuels de la critique et recherchent, via l’image, le son, le mouvement et la durée, les repères incertains mais intenses, des perceptions et des affects, d’un déclic, d’une émotion. Luis Buñuel, Claude Chabrol, Stanley Kubrick, Federico Fellini, Alfred Hitchcock, John Cassavetes, Charlie Chaplin, Andreï Tarkowski, Nanni Moretti, parmi tant d’autres, sont tour à tour invités comme témoins d’une investigation secrète et durable de l’obscur objet du cinéma. La psychose, folie proprement dite, est encore aujourd’hui la porte étroite par où se glisser dans ce monde mystérieux. Les arts plastiques, la littérature, la musique, la danse et les neurosciences ont entamé, ici et là, quelques brèches dans le mur qui nous sépare de cet univers. Mais le cinéma dispose de ses multiplicités. Le réalisateur espagnol Luis Buñuel a fait de l’incontournable réalité du désir le thème de son œuvre cinématographique. En réalisant le fantasme par le biais du surréalisme, dans la fiction du film, il a mis en lumière son origine irrationnelle. Avec “Le Charme discret de la bourgeoisie” et “L’Obscur objet du désir”, Buñuel fait tenir le fantasme sexuel pour l’envers secret de l’ordre bourgeois. Avec la férocité d’un style où la phobie, l’obsession, le fétichisme et les perversions ne sont jamais indemnes d’une culture de classe et d’une exploitation religieuse, il transpose au cinéma les processus d’élaboration du rêve cernés par la psychanalyse. Pour Alfred Hitchcock, un rêve est une énigme à interpréter. Il s’insère donc naturellement dans un thriller, et participe directement de sa problématique. C’est ce principe qui préside au scénario de “La Maison du Dr Edwardes”, une histoire de médecins et de psychanalystes plus ou moins pervers. Les indices qui permettent la résolution de l’intrigue ne sont plus placés dans la vie réelle mais dans les phobies et les souvenirs du héros. Par pans successifs, comme dans un puzzle, le récit filmique va construire la raison des troubles psychiques du protagoniste et livrer les clés de l’énigme policière. Très esthétique (Dali en a peint les décors), le rêve est construit selon une stricte référence à Freud. Mais le film n’est pas une Sphinge. Il s’attarde et jouit surtout de l’angoisse qu’il met en scène. La folie se manifeste, au cinéma, là où le réalisateur ne se propose pas, forcément, de la déceler, de l’expliquer. On la découvre, par exemple, dans une série de flash-back, avec “Citizen Kane”, d’Orson Welles. La folie se révèle ici à travers les groupes de pouvoir, les rapports de sexe, d’exploitation ou d’argent. Il s’agit, chaque fois, d’explorer une région du passé, avec des images en profondeur, chacune avec ses accents propres ou ses potentiels. Que Kane prononce le mot-clé de son enfance (“Rose bud”), au moment de la mort, n’est pas seulement l’indice d’un déchirement œdipien. C’est le dernier objet transitionnel, parce que dernier, de l’espace ludique de l’enfance. Annik Bianchini |
|
