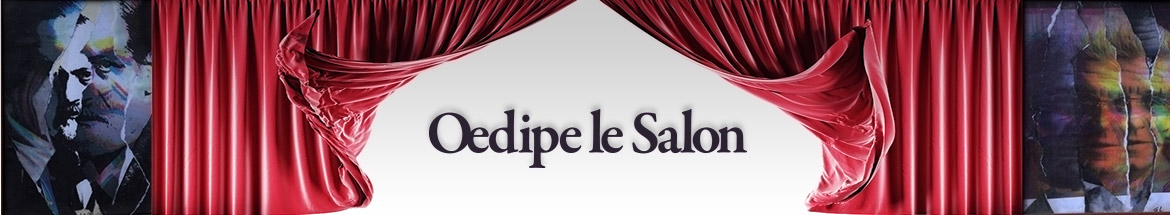|
Florence Reznik, |
|
Alain Lemosof propose avec Une après-midi d’analyse, une lecture par l’intérieur, des mouvements subjectifs qui opèrent dans une analyse. Le psychanalyste fait entendre ses interrogations fondamentales, concernant les sujets qui nous confient une part de leur existence souvent pour longtemps, notamment celle-ci : serai-je à la hauteur de cette tâche ? La question éthique est posée d’emblée. Le psychanalyste Vincent Siluvni va témoigner des dilemmes, des doutes qui l’animent, et de son implication dans le travail singulier à effectuer avec ses analysants, puis comment leurs paroles résonnent en lui. Comment entendre ce langage si particulier qui s’exprime à travers les formations de l’inconscient, les lapsus, les actes manqués, les rêves, et comment analyser en restant au plus près des dires du patient. Sont également abordés les problèmes plus sensibles liés à l’argent, au paiement des séances manquées, ainsi que les sentiments éprouvés parfois par le psychanalyste, tels que l’exaspération, la fatigue. Le souci d’être garant de « la parole dite et de ses conséquences, au risque d’une parole engagée » est présent. L’auteur montre de quelle manière les liens associatifs se produisent, se tissent, s’exploitent, et il sépare dans les mouvements du transfert, ce que le patient énonce pour faire plaisir à son analyste, et ce qu’il en est de la vérité de sa parole. Il accorde aussi une attention extrême aux petits détails ; il y a les imperceptibles modifications de l’humeur, du timbre de la voix, les postures physiques, le silence, tous les signes à entendre et à reprendre dans la cure. Il insiste sur le temps nécessaire pour faire advenir le sujet à sa vie. Je cite : « il songea au chemin parcouru, au temps nécessaire pour se dégager, chacun avec ses mots propres, des rails qui conduisent toujours à la même gare, sans avenir, et où l’on cherche inconsciemment à amener inexorablement l’autre, il fallait du temps ». Siluvni n’hésite pas à s’exposer à l’auto critique avec humour, quand il souligne les tics du psychanalyste, et de rappeler que l’analyste a été auparavant analysé lui aussi. « Le rappel en soi que l’on est passé par là ». Cette phrase m’évoque le propos du psychiatre Samuel Lajeunesse, qui énonçait : « entre interne et interné il n’y a souvent, que l’épaisseur d’un accent aigu ». L’auteur joue avec les rôles et donne la parole à ses analysants. Nous pourrons percevoir leurs doutes, angoisses, peurs, mécanismes de défenses, et les raisons conscientes et inconscientes qui les ont conduits à entreprendre une analyse. C’est une fiction nous avertit Alain Lemosof. Siluvni est-il un ovni ? Présente-t-il une vision idéalisée de la psychanalyse ou de ce que serait le psychanalyste idéal? « Pas une étude de cas mais une étude de cures » précise Alain Lemosof, et il souligne l’importance d’humaniser simplement ce qui se passe entre l’un et l’autre, de respecter la réalité psychique, la réalité matérielle, et le sujet avant tout. Un travail toujours sur le fil du rasoir, entre dire et taire, s’avancer, sortir parfois de la neutralité et inventer. Maintenir en permanence notre psychisme sur le vif. A une époque où la psychanalyse est parfois remise en question, Alain Lemosof, fait entendre de quoi est constitué ce difficile voire « impossible métier » comme l’avait énoncé Freud. Il contribue à redonner espoir en la parole et ses effets sur l’existence. Florence REZNIK |
|