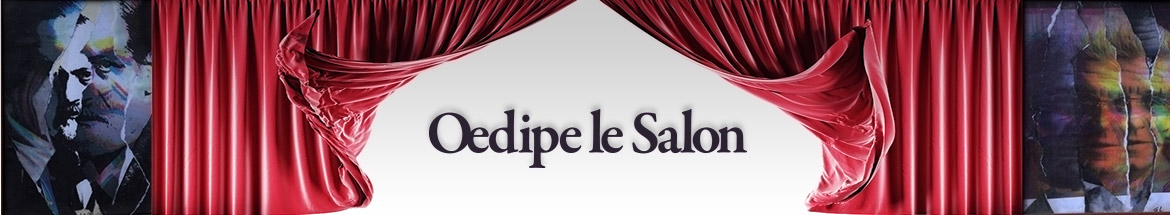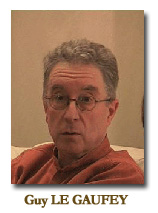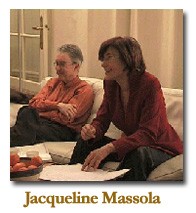|
|
J’ai eu un intérêt particulier à lire ce livre. Il m’a remis en mémoire un de vos textes que je suis allé rechercher dans les « Lettres de l’Ecole » 1979. Vous lui avez donné pour titre « Tantale logicien. » Il m’a semblé que vous aviez persévéré dans votre question. Et il m’intéressait de savoir comment vous avez mené ou orienté votre travail. Déjà en 1979, il s’agissait de la consistance logique, de la consistance des théories, de la consistance logique du savoir psychanalytique. Appui pris sur des références logiciennes (programme de Hilbert, Frege), vous considériez que cette logique était celle en jeu dans la psychanalyse (dans sa pratique et sa théorie) : De repérer une accointance entre ce que la logique moderne articule comme indécidable (qu’un système symbolique est toujours, en un point, défaillant) et ce à quoi le sujet a affaire : L’incomplétude. Que déjà vous disiez en ces termes : « Cet objet qui toujours se dérobe à la saisie, que peut-on en dire quant à son existence. » Vous avez persévéré, disais-je, dans cet abord logique, purement logique. Ce dont témoigne le sous-titre de votre livre : « Consistance logique, conséquences cliniques. » C’est l’armature forte de votre livre ; ça vous amène (latéralement ?) à quelques considérations plutôt réjouissantes sur ces fameuses « vignettes cliniques dont raffole le monde psychanalytique ». Ce jour vous abordez cet enjeu à partir de la logique revue par Lacan. Plus précisément par le carré logique aristotélicien revu par Lacan via Brunschwig. Comment tenir compte de votre travail de logicien dans le contexte lacanien ? Car Lacan a posé la question de la logique mais aussi de ses limites, de ses insuffisances quand il s’agit de psychanalyse. Autrement dit la question de la logique pas sans la topologie. J’insisterai – à vous suivre – sur un commentaire de ce carré logique. Ce commentaire vous l’enrobez dans une question de fond : Il s’agit pour vous de soutenir conjointement faille logique et faille sexuelle : le non rapport sexuel. « Quelle est l’opération linguistique qui fait exister homme et femme ? » questionnez-vous pour avancer une « conception de la différence sexuelle qui ne rate pas le problème logique sur lequel elle repose ». La clinique s’articule autour de la question de l’existence, de son enjeu. Vous avez choisi d’exposer, brillamment, la logique en jeu dans la psychanalyse, de dire cet enjeu avec la seule logique. Mais justement, cet objet « a », est insaisissable avec les pincettes de l’unité (en tant qu’elle ferait bord donc), ou y a-t-il à reconnaître là la logique ET son point d’insuffisance en ce qui concerne le sujet de la psychanalyse ? Que l’objet « a » puisse être dit n’avoir pas de rapport avec l’un c’est-à-dire pas de rapport avec la logique du nombre est vrai jusqu’ à ce point de renversement majeur ou il a affaire à la topologie des nombres réels. (Ce que vous réfutez, me semble-t-il, en une rapide note de bas de page.) N’y a-t-il pas là une lecture possible, dans ce cheminement spécifiquement de l’après-coup constituant du sujet ? Le pas-tout n’est pas localisable. Il n’existe que de l’inscription après coup. A été ramené de ce voyage la trace d’un redoublement de la négation, ce qui n’est pas rien. Cette coupure interne assure le sujet : Elle l’assure de la permanence du manque structural. N’est-ce pas là l’opération essentielle, celle du non rapport sexuel. C’est juste un ratage, c’est un ratage juste. Mais il m’a semblé pouvoir lire dans votre présentation « en scorie » du nœud borroméen un message subliminaire : que la topologie serait superfétatoire quant à la question de la psychanalyse. Cette scorie, en quelque sorte ferait preuve que la logique y suffit. Vous questionnez disons… sévèrement les vignettes cliniques appelées souvent à donner quelque illustration à des concepts confus. Plus précisément « la vignette illustre par un exemple démonstratif quelque énoncé trop aride et donc qualifié de théorique ». Sont visées là les vignettes qui réduisent le cas à ce en quoi il est entièrement déductible du concept référentiel. S’en efface dès lors tout ce qui fait problème, question : La singularité, c’est-à-dire l’existence même en tant qu’elle n’est pas toute déductible de l’universel. Peut-être un point encore sur les vignettes cliniques et leur rapport avec ce que j’appellerai la politique des institutions psychanalytiques : la vignette clinique qui pose, à partir du surplomb du concept, les cas qui font illustration, n’est-elle pas pervertissante ? Elle entraîne à réduire tout cas à sa congruence avec le concept, qui se constitue en dogme. Ce sont là procédures qui ne peuvent que servir le pouvoir. Ca s’adresserait à des débutants (pour bien leur illustrer l’affaire ?), à de non-initiés (non-initiés à la psychanalyse ? non-initiés à l’inconscient ?) pour leur faire entendre quoi ? Jacqueline Massola |
|
|
|
||
 |
 |
|
L’Invité : mardi 14 novembre 2006
Guy LE GAUFEY pour son livre "Le pastout de Lacan" Editions Epel Présentation de Jacqueline Massola