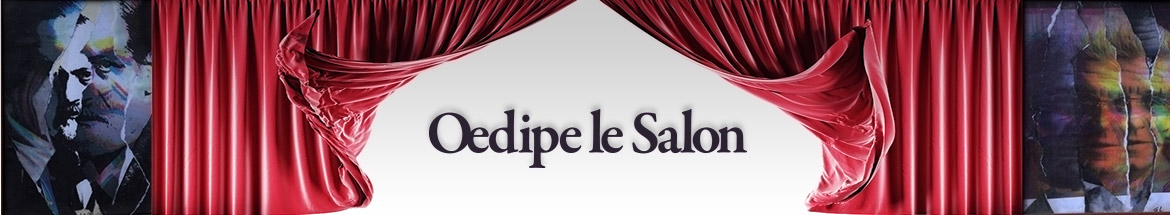|
|
En accueillant au salon Œdipe les livres parus dans l’année on peut être étonné de la vigueur de la théorisation disons post-lacanienne. Vigueur qui se traduit dans l’ampleur du projet annoncé par les auteurs : de la mise en place d’un nouveau concept à un remaniement amorcé de tout le corpus freudien. C’est le pas que vous proposez à votre tour : par la place prééminente que vous entendez donner à la voix (à la pulsion otique dites-vous) et ce qu’elle engage d’une révision (critique) des corpus freudien et lacanien. Sans compte la réorientation de la pratique. » Le refoulement freudien est oubli de la voix. » Telle est votre déclaration d’ouverture placée d’emblée dans un nécessaire contexte : celui de la mise en question de la méthodologie freudienne (puis lacanienne) dans les rapports que cette méthodologie entretient avec la science : » Freud a sacrifié l’hypnose à la science. Il s’est défaussé du recours à l’hypnose pour que la psychanalyse soit admise par le champ scientifique. « Cette version seconde comporte donc comme aide cette adresse au lecteur, adresse qui s’avère être feuilletée – et complexe. Au lecteur, vous annoncez donc que » ayant manifesté le désir de refonder la psychanalyse entière sur la reconnaissance du fait le plus évident pour toi… » Et ici, il faut tenir compte que c’est à vous-même que vous vous adressez, que vous dédoublez le lecteur en quelque sorte. Que vous relisez : » Refonder la psychanalyse entière donc sur le fait que sa pratique et les voltiges qu’elle implique ne tiennent et ne sont même possibles que par la voix tour à tour proférée et entendue » Et vous vous proposez » un champ conceptuel qui aurait pour axe la reconnaissance de la voix comme pulsion « . Avec une opération de nomination : proposition » d’appeler la pulsion invocante de Lacan pulsion otique « . Il s’agit de donner un » accès simple » aux questions théoriques et pratiques : » La voix est l’objet le plus immédiat du discours analytique » et » il s’agit de faire de la voix le levier de la cure et le point fixe pour une structure de la subjectivité « . Vous annoncez (toujours pour aider le lecteur) qu’il y a un fil rouge dans votre livre et qu’il s’agit de » la croyance en la voix « . J’ai essayé en bonne lectrice de me débrouiller avec la consistance de ce fil rouge jusqu’à ce que s’impose à moi l’existence d’un autre fil doublant ce premier. Le souci de la transmission de la psychanalyse, de son enseignement, question centrée sur ce que vous proposez être le projet de Lacan : « Lacan s’est voué à faire entendre la voix silencieuse de Freud. » Une autre composante, et pas des moindres, de votre livre est un brillant exercice non de la psychanalyse appliquée à la littérature (conception que vous réfutez) mais de la » littérature comme lieu d’implication de la psychanalyse, occasion d’inventer ce qu’elle ne sait pas déjà nécessairement. De ces différents fils donc ce qui en fin de compte ferait l’unité de votre livre, ce qui double le fameux fil rouge ( » la croyance en la voix « ) serait la question permanente du rapport de la psychanalyse à la science, c’est-à-dire le travail de Freud et de Lacan pour établir les corpus psychanalytiques dans un certain rapport à la science. C’est une question que vous prenez – en connaissance de cause je suppose – non pas par le bord de la scientificité de la psychanalyse, du degré de scientificité de la psychanalyse, mais par ce bord où vous avancez que les corpus freudien et lacanien pêcheraient du fait d’un sacrifice fait à la science. Vous insistez ainsi sur ce sacrifice premier que j’ai cité en introduction en le couplant à Lacan, sans ambiguïté : » Méconnaître l’hypnose en proclamant la nécessité de l’abandonner comme le prétend Freud ou en proposant d’instaurer une logique du signifiant comme y invite Lacan qui confond ainsi vocal et littéral. « Ainsi, le fil de cette question court. » Nécessité pour la psychanalyse de rompre avec l’obligation d’universalisation de la science. » Le champ de la science pour être consistant présuppose des limites à la formalisation : qu’en soit exclu le paradoxe. Et elle n’est pas sans poser comme contenu résiduel intuitif ce qui fait borne à la formalisation. De départ, la psychanalyse fait avec (ne fait pas sans) ce qui est exclu. Et Lacan, en progrès sur Freud, ne fait-il pas justement place au paradoxe et sur une modalité qui ne s’oppose pas à la science ni y sacrifie ? C’est quasiment la fin de mon grain de sel. Car à vous suivre, si vous estimez – et ceci dès 1975 (j’ai retrouvé cette citation dans un de vos articles) – que l’hypnose c’est la voix comme ombilic du rêve. » L’hypnose est l’unique moyen de rendre compte de l’élément mythique inhérent à la nature du désir. » Est-ce là une formulation à la structure du désir lacanien ? Vous laissez la question de la scientificité vous rejoindre : » Toute conceptualisation implique que l’on sorte de ces grands cadres de généralisation que sont l’espace euclidien et le temps chronologique. » Vous rejoignez par là votre filiation lacanienne, car n’est-ce pas que la logique du signifiant lacanien que vous mettez en question réalise, et plus encore la topologie lacanienne ? Il y aurait bien, disons, un fil disjoint du côté de la transmission qui vous fait écrire, à propos du projet de Lacan, » de faire entendre la voix silencieuse de Freud « , que c’est un projet raté. Ratage que vous référez essentiellement à la position subjective de Lacan dans sa filiation : » Ce retour à Freud est déguisement d’une déception et d’une haine du père à peine analysées… assouvissement d’une haine déguisée. » Vous justifiez cette affirmation par des arguments portant sur la méthodologie lacanienne (avec un feed back sur Freud qui aurait, lui aussi, sacrifié à la science). » Lacan présente un système hégélien impénitent ( ?) sans que ne soit jamais avouée ( ?) la moindre contradiction. Lacan… est un théoricien affecté d’un symptôme de fuite en avant qui le rend incapable de se relire… Il a rationalisé l’aveu… de ce symptôme gênant : celui de laisser des traces écrites sur lesquelles il lui faudrait revenir. » Le dévouement de Lacan à » faire entendre la voix silencieuse de Freud « , et le choix de l’enseignement oral se réduirait donc à un symptôme. On dira que c’est votre opinion car sur le plan de ce qui en serait d’une critique méthodologique, de quoi s’agit-il ? Est-ce de votre part tentative de repérer la procédure scientifique de Lacan ? Lui reprocheriez-vous d’être embarqué dans l’hypothético-déductif et dans la méconnaissance de la réduction axiomatique ? Accessoirement, puis-je vous demander en quoi la haine – sachant que l’amour ne règne pas en maître dans les institutions psychanalytiques – trouble la théorisation ? Jacqueline Massola |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
L’Invité : mardi 11 mai 2004
Jacques NASSIF pour son livre "L’écrit, la voix" Editions Aubier Présentation par Jacqueline Massola